Dans son dernier essai Les Surgissants, ces terroristes qui viennent de nulle part, paru en 2022, aux éditions Rue de Seine, l’anthropologue David Puaud s’intéresse à la radicalisation en termes de questionnement social et identitaire. Il aborde plus spécifiquement la radicalité religieuse. Il revient sur le dispositif de sa prise en charge en milieu ouvert, mis en place par l’État en 2016 et intitulé Rive (Recherches et intervention sur les violences extrémistes). Entretien.
Comment définiriez-vous la radicalité ?
David Puaud. Je n’aime pas trop ce terme. J’appelle ça un signifiant flottant, car il veut tout dire et rien dire. Les radicalités sont plurielles. On voit bien que, dans notre pays, depuis maintenant une trentaine d’années, la question sécuritaire a remplacé dans certains domaines la question sociale, avec une affirmation identitaire forte aussi illusoire qu’utopique, qui n’a fait qu’accentuer des formes de radicalités plurielles. Aujourd’hui, la radicalité englobe des mouvements fascistes, écologistes, complotistes… Le prisme religieux n’en est qu’un des aspects.
Vous avez été confronté à des « revenant·e·s » avec le programme Rive. Pouvez-vous nous parler de votre travail au sein de ce dispositif ?
En 2017, j’ai été contacté par Samantha Enderlin qui était à l’époque directrice du dispositif Rive . Le ministère de la Justice a mis en place à Paris un programme secret de désengagement. On ne parle plus de déradicalisation. Ce dispositif expérimental va fonctionner pendant un an et demi. Sa richesse : allier des savoirs pratiques pluridisciplinaires. Grâce à l’appui de professionnels : qu’ils soient éducateurs, psychocriminologues ou chercheurs en sociologie et en anthropologie. Je fais partie de ces derniers.
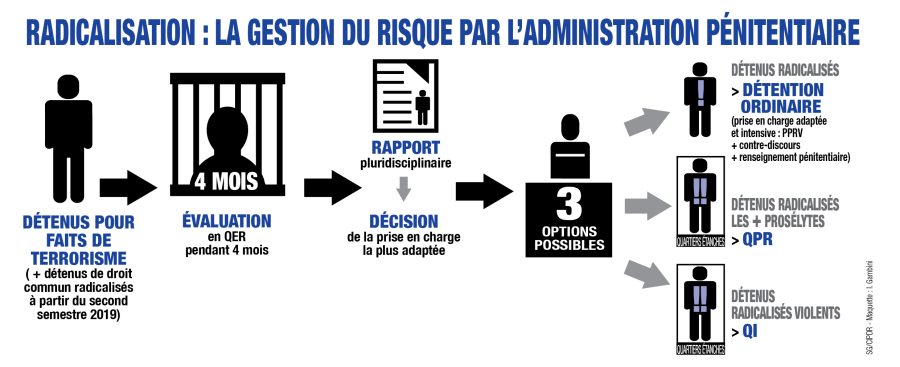
Concrètement, en quoi a consisté votre mission ?
J’ai été missionné sur la question du mentorat : comment mettre en place un partage de savoirs ou d’expériences communes avec les prévenus et leurs accompagnants. J’ai étudié le dossier de vingt-quatre personnes placées sous main de justice pour des faits de radicalisation (sans pouvoir approcher les personnes elles-mêmes). Parmi elles, il y a des « revenant·e·s », mais également des personnes repérées par les services de renseignement pour avoir eu des propos, réellement prononcés ou publiés sur internet, exprimant une volonté de commettre un acte terroriste. À partir de ces vingt-quatre dossiers, j’ai élaboré une typologie, focalisée plutôt sur des situations descriptives. Ce sont quasiment tous des jeunes âgés de 18 à 24 ans, et 75% sont des hommes. Tous sont en perte de repères, avec un sentiment d’appartenance très flou et une absence de projection sociale. La question religieuse n’est en fait qu’un prétexte.
Quel bilan plus général en tirez-vous ?
Force est de constater que, dans la trajectoire de tous ceux qui sont passés à l’acte sur le territoire français, les questions sociales, l’accompagnement, la délinquance, et les traumatismes ressortent fortement. Par ailleurs, mon travail d’anthropologue m’a conduit dans des quartiers paupérisés de Thionville, Vesoul, Metz, Saint-Étienne-du-Rouvray, et Dieppe, où le tissu économique et ouvrier est en déliquescence. Et où le chômage est important, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Dans tous ces parcours, on note aussi une rupture progressive des liens institutionnels, scolaires, amicaux et familiaux, donc un isolement social. C’est aussi cela qui fait la force des réseaux radicaux : ils promettent une place et une reconnaissance ici mais également dans l’au-delà.
« Le terme « radical » renvoie à des représentations essentialistes qui renforcent les stigmates dont souffrent déjà certains jeunes. De « racaille », on est passé à « radical », avec un potentiel criminel »
David Puau
La radicalité religieuse est-elle nouvelle ?
Le terme de « radicalité », employé en lien avec la religion, a d’abord été utilisé lors des attentats de 2001 aux États-Unis. Il a été repris en France en 2012, notamment après les attentats de Toulouse et de Montauban perpétrés par Mohamed Merah. Puis à partir de 2015, où il a largement été diffusé au moment des attentats de janvier et de novembre. Dès lors, ce mot est devenu une catégorie en soi, mais très floue, raison pour laquelle je préfère parler de spectre de la radicalisation. La définition même du terme « radical », qui a à voir avec la racine, fait écho à une problématique ethnique et raciale qui m’a toujours inquiété. Ce terme renvoie à des représentations essentialistes qui renforcent les stigmates dont souffrent déjà certains jeunes. De « racaille », on est passé à « radical », avec un potentiel criminel.
La radicalité est-elle toujours liée à la violence ?
Pour moi, la question de la violence précède celle de la radicalisation. La radicalité en soi n’est pas violente. Ce qui est inquiétant, c’est lorsque quelqu’un a une propension à s’affirmer par la violence et à commettre un acte de violence extrême, sous couvert de convictions religieuses, politiques ou d’autres croyances. En 2014, avant les attentats, j’ai mis en place avec un collègue une formation intitulée « Jeunes en voie de radicalisation, mythe, réalité et travail social » à destination des travailleurs sociaux et des éducateurs de rue. La première session a eu lieu en février 2015 à la suite des attentats de Charlie Hebdo, la deuxième en novembre de la même année après celui du Bataclan. Ces attentats sont ce que je nomme des « moments emblématiques ».
Pourquoi cette dénomination ?
Parce qu’ils vont marquer la société sur un plan émotionnel et physique et cristalliser une représentation de la radicalité . Je constate que le poids de ces moments emblématiques fait qu’aujourd’hui, il y a des cours d’assises spéciales qui n’existaient pas auparavant et qui peuvent condamner ces personnes à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’un régime de sûreté de trente ans, ce qui n’était pas le cas avant.
Comment aide-t-on une personne à sortir de la radicalité ?
Par ce que j’appelle « la mètis intrastructurelle ». Il s’agit d’user de ruses, de stratégies particulières pour retravailler la civilité. Ainsi, avec les professionnels, on va travailler sur le parcours de vie de la personne et éveiller progressivement son libre arbitre, afin de la conduire à remettre en question ses certitudes. Par exemple, un éducateur a repéré que l’un des arrière-grands-pères d’un jeune, Mohamed, a combattu à Verdun. Ensemble, ils se sont donc rendus sur place et ont visité l’ossuaire de Douaumont. Là-bas, ils ont découvert la plaque de l’arrière-grand-père tunisien venu de Zarzis, à côté de Djerba. Sur le chemin du retour, Mohamed a reparlé de son histoire, y compris de choses très personnelles, qui ont permis d’enclencher un suivi et de renouer le dialogue avec son père avec qui il était alors en conflit. Donc ruser, ce n’est pas tromper, mais mettre en place des stratégies pour permettre le retour de la parole. Plus on favorise l’inclusion sociale et le sentiment d’appartenance à la nation, plus le curseur des velléités violentes et radicales va diminuer.
Les moyens publics sont-ils au rendez-vous ?
Non, clairement non. Il y a une baisse drastique des financements publics liés au travail social. Il y a également une souffrance des professionnels confrontés à des situations dramatiques. Celles de jeunes ou de moins jeunes qui cumulent des difficultés financières et psychologiques. Tout d’abord, il faudrait augmenter les moyens de tous ces secteurs, et ensuite, former plus de professionnels. Mais malheureusement, ce n’est pas le modèle préconisé. Il s’agit davantage d’intervention sociale que de travail social. Je suis donc assez pessimiste. J’aime cette formule d’Antonio Gramsci, que je cite souvent : « Pessimisme de l’intelligence, mais optimisme de la volonté ». Optimisme quand même donc, parce que, en tant que formateur, je vois sur le terrain qu’il y a plein de professionnels en devenir qui y croient, qui agissent, bricolent, inventent et rusent, avec peu de moyens au quotidien.

Texte : Pamela Eanga – Photos : Nathalie Fristot

